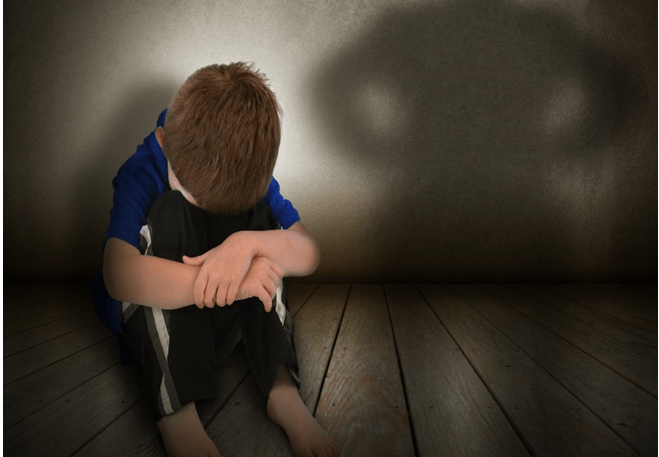Catégories :
Mots clés :
J’en étais à ma 18è ou 19è tentative, assis dans le jardin du bureau de l’AFP à Kaboul pour avoir une meilleure communication téléphonique. J’essayais désespérément de joindre un père de famille dans la province reculée d’Uruzgan. Son « joli » adolescent avait été enlevé par un commandant de police pour en faire son esclave sexuel, selon des anciens du village.

J’étais sur le point d’abandonner quand la communication est passée, le grelot d’une sonnerie ayant finalement remplacé le message, en langue pachtoune, d’un « correspondant non joignable ».
Mais quand le père a répondu, il a refusé de parler, à mon grand désarroi. C’était peut-être la peur, ou bien la honte. « Votre histoire ne changera rien du tout », m’a-t-il lancé sur la ligne avant de raccrocher.
Je suis arrivé à une conclusion amère. J’essayais de briser un mur de silence.
Je ne me suis jamais senti aussi seul, en tant que journaliste, qu’en essayant de rapporter cette histoire. Une histoire dont personne ne voulait entendre parler. Une histoire enveloppée dans un voile de honte. L’histoire du « bacha bazi », c’est-à-dire « jouer avec les garçons », en langue dari.

Dans les mois qui ont suivi, le scénario s’est répété maintes fois, pendant que je cherchais les victimes d’abus sexuels sur des mineurs. Mais j’ai ressenti l’obligation de continuer. Parce que cette histoire devait être racontée.
Quelques semaines avant, pendant l’été 2016, j’avais rapporté comment les talibans utilisent des enfants esclaves sexuels comme des chevaux de Troie, pour tuer les policiers qui abusent d’eux.

Ce scoop avait provoqué une levée de bouclier.
Le président afghan, Ashraf Ghani, avait ordonné une « enquête minutieuse » sur cette pratique, en assurant qu’elle ne serait pas tolérée dans les forces de sécurité afghanes.
L’affaire avait aussi renforcé les appels de parlementaires américains à en finir avec le « bacha bazi », au besoin en adoptant des sanctions ciblées contre les chefs de la police qui en sont responsables.
En privé, des officiels afghans en colère m’ont accusé de chercher « à salir la réputation de l’Afghanistan ». Mais ceci est une autre histoire.
La seule chose étrangement absente dans tous ces échanges était le sort de ces enfants asservis, de leurs familles et des efforts du gouvernement, ou l’absence d’effort en l’occurrence, pour les tirer des griffes de leurs maîtres.
« Les sauver, mais pour les envoyer où ? », m’a demandé un représentant occidental, lors d’une soirée privée à Kaboul.
« L’Europe explose », a-t-il ajouté, en référence à la crise migratoire touchant le continent européen.
Cette justification pour ne rien faire, m’a laissé sans voix.
Je n’ai recueilli que des haussements d’épaule, en cherchant de l’aide auprès de la communauté diplomatique pour un enfant esclave que j’avais rencontré dans un coin perdu d’Uruzgan. Un garçon frêle aux yeux tristes et délavés, aux mains d’un commandant de police depuis deux ans.

L’opinion de mes interlocuteurs tenait en quelques mots : c’est dans leur culture. La priorité est au règlement d’un conflit qui empire ; le sort des enfants maltraités attendra.
Cette indifférence stupéfiante m’a poussé à entamer une quête de plusieurs mois à travers trois provinces afghanes, pour trouver ces jeunes victimes et leurs familles.
Leurs témoignages, recueillis principalement dans le sud d’Helmand, mais aussi dans les provinces voisines d’Uruzgan et du nord de Baghlan, ont apporté des détails troublants à un tableau déjà glauque.
Parfois remarquablement similaires, ces récits ont levé le voile sur le combat solitaire et vain de familles afghanes pour empêcher leurs enfants, neveux ou cousins d’être la proie d’une tradition bien enracinée d’asservissement et de viol.

Ces témoignages ont surtout contredit le récit habituel sur l’origine de ces jeunes esclaves sexuels. On les a souvent dit issus de familles pauvres qui les vendent à des commandants influents ou bien ayant choisi cet asservissement par appât du gain, pour obtenir des cadeaux ou de l’argent.
Mais les 13 témoignages que j’ai recueillis ont mis au jour une épidémie d’enlèvements. Le plus souvent les enfants ont été enlevés en plein jour, directement à leur domicile, dans les champs d’opium ou sur les terrains de jeux.

Des commandants de police puissants kidnappent eux-mêmes les enfants qu’ils sont censés protéger. Ce qui ne laisse aucune chance aux familles qui en sont victimes, dans un système sans loi contre cette pratique, sans moyen de recours et où apparemment aucun responsable n’agira contre des coupables sur lesquels on compte par ailleurs pour se protéger des talibans.
« Auprès de qui trouver de l’aide ?», m’a dit un homme de Helmand dont le beau-frère, un adolescent, a été enlevé. « Chez les talibans ? »

La pratique du « bacha bazi » n’est pas vraiment considérée comme homosexuelle ou non-musulmane. Au point qu’elle donne lieu à une véritable compétition entre les responsables de la police. C’est à celui qui capturera les plus jolis garçons.
Les plus prisés « n’ont pas vu le soleil depuis des années », un euphémisme pour qualifier un jeune garçon dont la beauté est encore intacte.
Dans cette société où les genres sont strictement distincts et séparés, la possession d’un beau garçon efféminé est garant de statut social, de pouvoir et de masculinité.
Des parents en sont venus à habiller leur progéniture de vêtements sales et boueux pour ne pas susciter la convoitise de policiers en chasse.
« Le +bacha bazi+ détruit notre société », m’a dit un activiste de la province de Helmand. « Nos enfants grandissent avec la conviction qu’il est normal de violer un garçon ».

Certains policiers sont connus pour exhiber fièrement leurs conquêtes.
Le témoignage le plus poignant a été celui de Sardarwali, qui après des mois d’une quête infructueuse a aperçu son fils enlevé dans un marché bondé du district de Gereshk, dans le Helmand, où j’ai recueilli le plus grand nombre de témoignages.
Sardarwali rêvait de pouvoir approcher son fils, de le prendre dans ses bras, mais il n’a pas osé approcher le cercle de policiers qui l’entourait.
« Je l’ai regardé disparaître », m’a dit Sardarwali. « Sa mère est folle de douleur. Elle ne peut s’arrêter de pleurer en disant :+Nous avons perdu notre fils pour toujours+ ».
L’horreur de voir son enfant livré à un esclavage sexuel est aggravée par l’idée qu’en captivité, les garçons deviennent dépendants aux opiacés qu’on leur donne pour les rendre soumis.
Plus atroce encore est la crainte que leur progéniture soit enrôlée de force pour défendre les frontières, où les forces de l’ordre connaissent des pertes record aux mains des talibans. Ou qu’elle soit tuée dans des échanges de tirs, quand le postes de police où elle est détenue est assailli par des insurgés.

Souvent la seule issue pour un bacha esclave est de passer un pacte avec les talibans :
«Libérez moi et je vous aiderai à obtenir la tête et les armes de celui qui me possède », m’a expliqué le responsable occidental.
Des familles trouvent un réconfort amer dans le fait qu’elles ne sont pas seules. Leurs villages abritent souvent des victimes du « bacha bazi », abandonnées par leurs exploiteurs quand leur barbe commence à pousser.
La plupart de celles que j’ai interrogées ont abandonné tout espoir. Une seule famille de Helmand a eu la chance d’extirper son garçon de 11 ans d’une captivité qui a duré seulement 18 jours, avec l’aide d’un responsable influent des services secrets afghans.
«Sa famille réclamait justice mais je leur ai dit, Fuyez la province ou bien ils reviendront pour chercher votre garçon », m’a dit ce responsable. « Le bacha bazi n’est pas un crime impliquant une punition ».
Après des semaines de recherche, une équipe de l’AFP a retrouvé le garçon dans un endroit anonyme et reculé du sud de l’Afghanistan, où il vit dans une réclusion virtuelle deux ans après son épreuve.
L’adolescent aux yeux vitreux, luttant visiblement pour surmonter ses séquelles psychologiques, est resté assis en silence aux côtés de son père, courbé au-dessus d’un plateau de thé et sucreries, incapable de raconter ce qu’il a subi aux mains de son ravisseur.

Au bout du compte, ces témoignages ne sont sans doute qu’une mince illustration d’un problème ancré profondément dans la société afghane.
De nombreuses familles ont été trouvées avec l’aide d’activistes, de responsables tribaux ou de communautés. Des familles ont menées à d’autres familles. Certaines, au fond de provinces reculées, se sont révélées injoignables pour des raisons de communication ou de sécurité. D’autres, comme celles de ce père d’Uruzgan, ont refusé de parler.
Et des activistes qui s’étaient dit prêts à aider, ont préféré ensuite ne pas livrer leurs sources, de peur de provoquer les autorités locales.

Le problème n’a aucune chance de disparaitre à court terme et la plupart des victimes et leurs familles n’obtiendront pas justice. Mais peut-être y-a-t-il un rayon d’espoir avec la brèche ouverte dans le mur de silence qui enveloppe cette pratique.
Le sujet, à partir de mon enquête, a été abordé dans une table ronde à la télévision locale, quelque chose que je n’avais encore jamais vu.
Qui sait, peut-être qu’au bout du compte, le silence ne sera plus tenable.
Source : making-of.afp.com
Source(s):
Les articles en liens


Montreuil | Jugé pour avoir violé sa belle-fille pendant deux ans

Tulle | Un pédocriminel père de famille libre alors qu’il regardait de la pédopornographie

Loudun | 9 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur une mineur