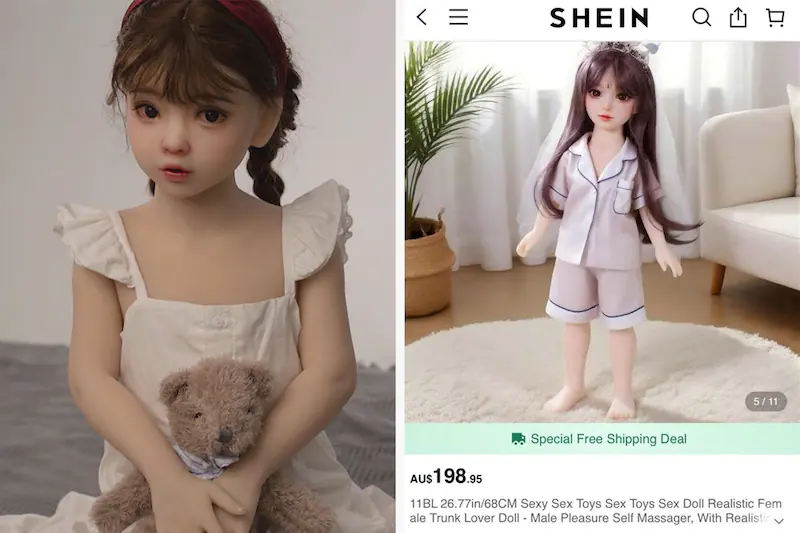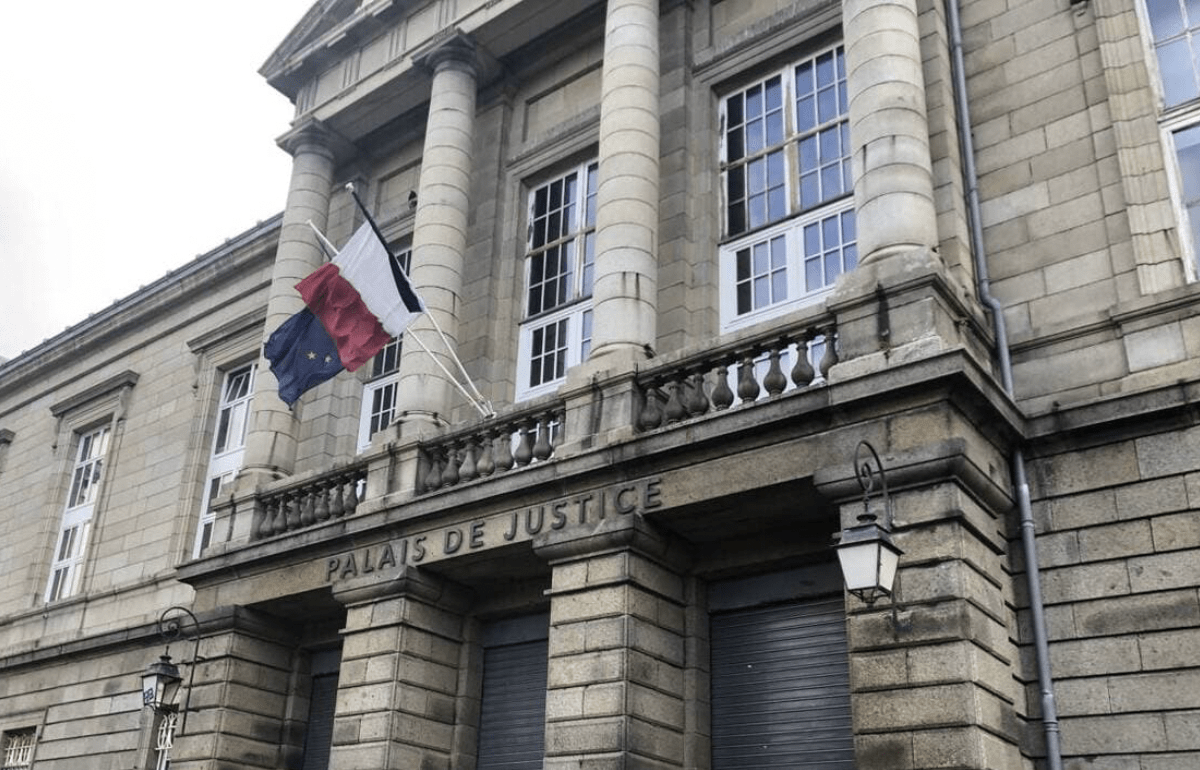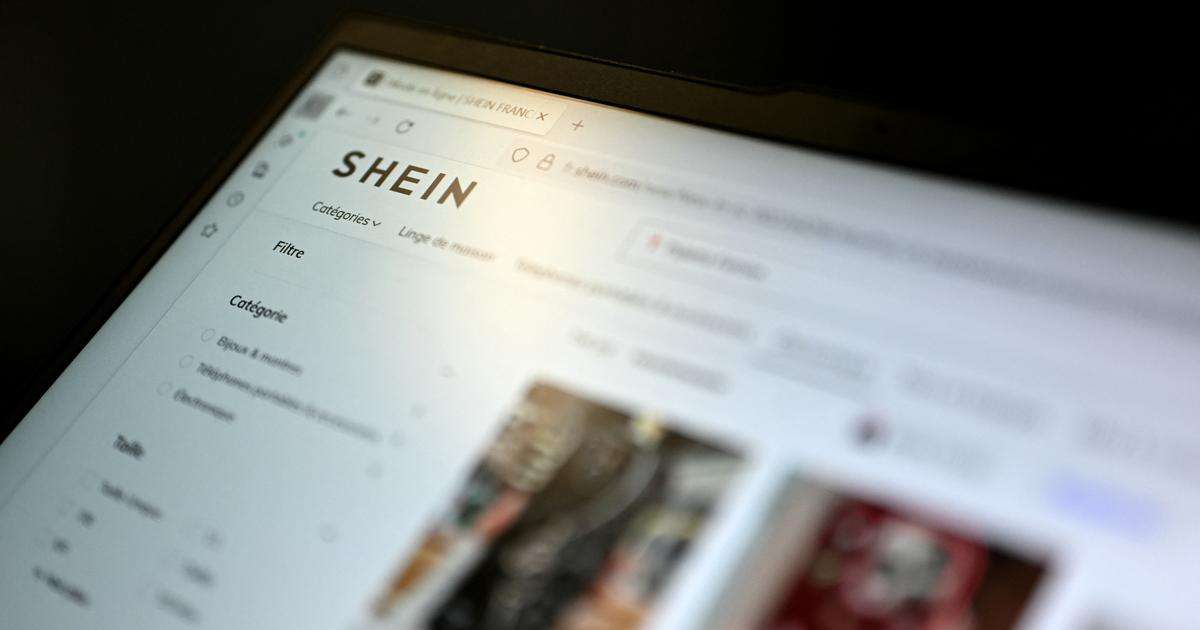Loire-Atlantique | Prostitution des mineurs : “Séquestration”, “viol collectif”
- La Prison avec sursis... C'est quoi ?
non
- 07/10/2025
- 19:05
Catégories :
Mots clés :

Un fléau qui touche majoritairement des filles de plus en plus en plus jeunes au profil polytraumatique.
Le département de Loire-Atlantique travaille sur le phénomène depuis trois ans. Depuis 2022, l’exploitation sexuelle des mineur.e.s est mieux repérée et mieux connue par les institutions et les professionnels, mais elle est en constante augmentation.
150 professionnels de l’éducation nationale et de la protection de l’enfance ont répondu à un questionnaire. 119 situations d’exploitation sexuelle y ont été décrites. Les témoignages recueillis sont glaçants.
En voici quelques uns :
De 20 à 30 passes par jour
“La jeune était séquestrée dans le logement dans un lieu inconnu. Elle était d’origine étrangère et ne parlait pas français. Elle n’était pas alimentée”.
“La jeune est rentrée plusieurs fois au foyer avec des bleus sur tout le corps ainsi que des MST”.
“Elle est à nouveau partie en fugue dans la journée du 29 vers 18 heures. Elle est revenue au foyer le 30 vers 10 heures 30 de son fait, dans un état que nous avons trouvé second, et a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec des hommes, qui ont entraîné des saignements, ainsi qu’une consommation de drogue (cocaïne et ecstasy).”
“Viol collectif dans une cave, plus de 16 heures de suite. Un travail forcé où la jeune a enchaîné les passes en étant droguée et violentée.”
“Enfermée dans un hôtel ou Airbnb plusieurs jours, entre 20 et 30 passes par jour. 8 à 10 heures de viols non-stop.”
Le dispositif pluridisciplinaire d’accompagnement global des victimes “Alba” a ,de son côté, accompagné plus de 500 mineur.e.s en Loire-Atlantique depuis sa création en 2021.
“C’est un phénomène qui prend de l’ampleur parce qu’il est visibilisé, parce qu’on en parle, parce qu’enfin, il y a des études, enfin, il y a une politique qui s’intéresse à ce sujet, mais ce qu’on peut dire quand même malgré tout c’est qu’il y a une augmentation du fait des réseaux sociaux déjà, qui donnent beaucoup plus de latitude aux auteurs pour capter des victimes, et puis de l’impunité. L’impunité qui fait qu’aujourd’hui, les condamnations sont parfois plus élevées quand on deale du stup que quand on exploite sexuellement des enfants.”, explique Léa Messina, responsable du dispositif “Alba” – “Mineur.e.s en situation de prostitution.
“Les enfants qu’on accompagne elles ne se considèrent pas victimes et donc de fait, elles ne vont pas dénoncer les proxénètes, elles ne vont pas les conscientiser comme agresseurs, comme auteurs de violences, donc lorsqu’il y a une enquête et qu’elles sont reçues, elles vont dire non mais moi, je gère, il n’y a pas de souci, personne ne m’a rien demandé”
, ajoute-t-elle.
Elle pointe le manque de moyens ; “aujourd’hui, il y a un manque criant pour les services de police, pour les services de justice, pour pouvoir répondre à ces enquêtes qui demandent du temps, de la formation, de l’énergie et qui sont comme pour nous sur l’accompagnement un marathon avec des enfants qui vont faire des allers-retours et pour lesquels il va falloir comprendre dans quel type de réseau, elles s’inscrivent.”
Des séquelles irréversibles
Si les violences sexuelles pendant l’exploitation restent peu exposées dans le questionnaire, les séquelles en revanche sont bien identifiées.
57 % des enfants sont dans un état de stress aigu, 56 % sont atteints de trouble anxieux. Beaucoup souffrent de déséquilibre alimentaire, 31 % de problèmes gynécologiques.
Sur le plan social, 72 % sont en décrochage ou en échec scolaire. Sur le plan relationnel, 49 % ont perdu confiance en elles.eux et en l’adulte.
Les situations relatées en disent long.
“Elle est devenue accro aux drogues”. “Exclue de son établissement pour absentéisme”. “La victime a été traitée pendant un an pour une MST, elle a dû avorter”.
“La victime offrait son corps pour une cigarette”.
“Il était plus simple pour la victime de rester dans un état dissociatif”.
“La jeune fugue tous les soirs pour se défoncer et elle se fait mal tous les jours”.
L’enquête ne manque pas d’exemples, tous plus insupportables les uns que les autres.
“La complexité, c’est le psychotrauma d’abord, le continuum de violence, on est face à des enfants qui ne se considèrent pas victimes et donc la question, c’est comment on va devoir prendre du temps pour se mettre à leur temporalité et pour permettre de visibiliser les systèmes de violence, visibiliser les systèmes d’emprise, leur permettre de déconstruire l’impression qu’elles ont de gérer, d’être autonome”
, souligne Léa Messina.
“Ce qu’on voit, c’est qu’en fait par le biais du proxénétisme ça leur donne un contrepoids comme de l’empouvoirement, ça veut dire là où avant, j’ai été victime de violence dans mon parcours, là où j’ai subi, aujourd’hui, j’ai l’impression que je reprends le contrôle grâce à l’exploitation sexuelle et nous, on va venir déconstruire ça, détricoter les stratégies d’auteurs pour dire à ce moment-là c’est de la violence. C’est de l’emprise, mais en fait parfois, on n’est pas aussi bon et face à nous, on a des gens qui donnent une forme de protection à des enfants qui sont habitués à la violence donc il va y avoir cet aller-retour de dire, je cherche à être protégé, mais je ne sais pas ce que c’est d’être protégé alors que les systèmes de violence ça, c’est quelque chose que je connais”, poursuit-elle.
Une majorité de filles connues de l’Aide Sociale à L’Enfance
92 % des victimes sont des filles, 87 % des enfants bénéficient d’une prise en charge par l’ASE.
L’âge moyen au début de l’exploitation sexuelle est de 14 ans et 3 mois. Celui du repérage de 15 ans et 1 mois. La plus jeune victime a 12 ans.
“C’est le symptôme d’une société qui ne voit pas, nous avons aujourd’hui la chance de très bien travailler avec la protection de l’enfance. Nous ne sommes pas un dispositif de la protection de l’enfance et donc en effet, c’est en très grande majorité des enfants de l’ASE parce qu’il y a la question des vulnérabilités, des carences, du continuum de violence. Nous, notre problème aujourd’hui, il est le repérage de ces enfants qui ne sont pas au sein de la protection de l’enfance, qui sont exploités sexuellement, mais pour lesquels il y a un défaut de repérage donc on a besoin de l’éducation nationale qui repère de plus en plus, mais on a aussi besoin des parents pour qu’ils comprennent. Quand les parents nous appellent, on est déjà sur des situations extrêmement graves avec des enfants qui sont dans une violence extrême. On peut parler d’actes de torture et de barbarie”, appuie Léa Messina.
“L’enjeu aujourd’hui c’est de se dire oui, majoritairement sur les chiffres, c’est la protection de l’enfance parce qu’il y a des vulnérabilités, mais ça ne veut pas dire que c’est la réalité sur le terrain. Ce que ça veut dire c’est qu’on a un défaut de protection des enfants qui ne sont pas pris en charge”
, déplore-t-elle.
Des signaux d’alerte mieux identifiés
Absentéisme scolaire, résultats en baisse, fugue, consommation d’alcool, de drogue ou de médicaments, dégradation de la santé mentale, gestes autoagressifs, surconsommation des réseaux sociaux et des moyens de communication, possession d’argent, de nouveaux objets. Tous ces signaux sont des marqueurs pour les professionnels interrogés.
Des violences en amont de l’exploitation sexuelle
Carences éducatives, violences intrafamiliales, conflit familial, agression extérieure au foyer, 94 % des mineur.e.s ont vécu au moins une forme de violence dans l’enfance.
Le dispositif Alba rapporte que 100 % des enfants victimes accompagné.e.s ont été victimes de violences en amont de l’exploitation sexuelle. Un écart qui peut s’expliquer par le fait que les professionnels n’ont pas toujours connaissance du passé des enfants avant leur orientation.
“Il n’y a pas assez de place, il n’y a pas assez de professionnels et donc on ne peut pas réduire les coûts partout et après se dire qu’on a les moyens de bien faire notre travail. Nous nous sommes confrontés à des équipes qui sont extrêmement engagées qui ont envie de bien faire, mais qui sont épuisés qui n’en peuvent plus qui n’ont pas le temps et qui ont un sentiment de défaut de protection qui est très fort. Il faut arrêter de trouver un ennemi commun qui serait la protection de l’enfance et se dire qu’aujourd’hui, on ne protège pas bien nos enfants, on n’a en fait pas les moyens de le faire”, rappelle le responsable du dispositif “Alba”.
Avec Cathy colin
Comment reconnaître un proxénète et comment réagir ?
Voir cette publication sur Instagram
Une publication partagée par France 3 Pays de la Loire (@france3pdl)
Source(s):
Les articles en liens


Népal | Deux Français récidivistes arrêtés pour tourisme sexuel sur mineurs
Douai | Assises : Un Fourmisien condamné à huit ans de prison
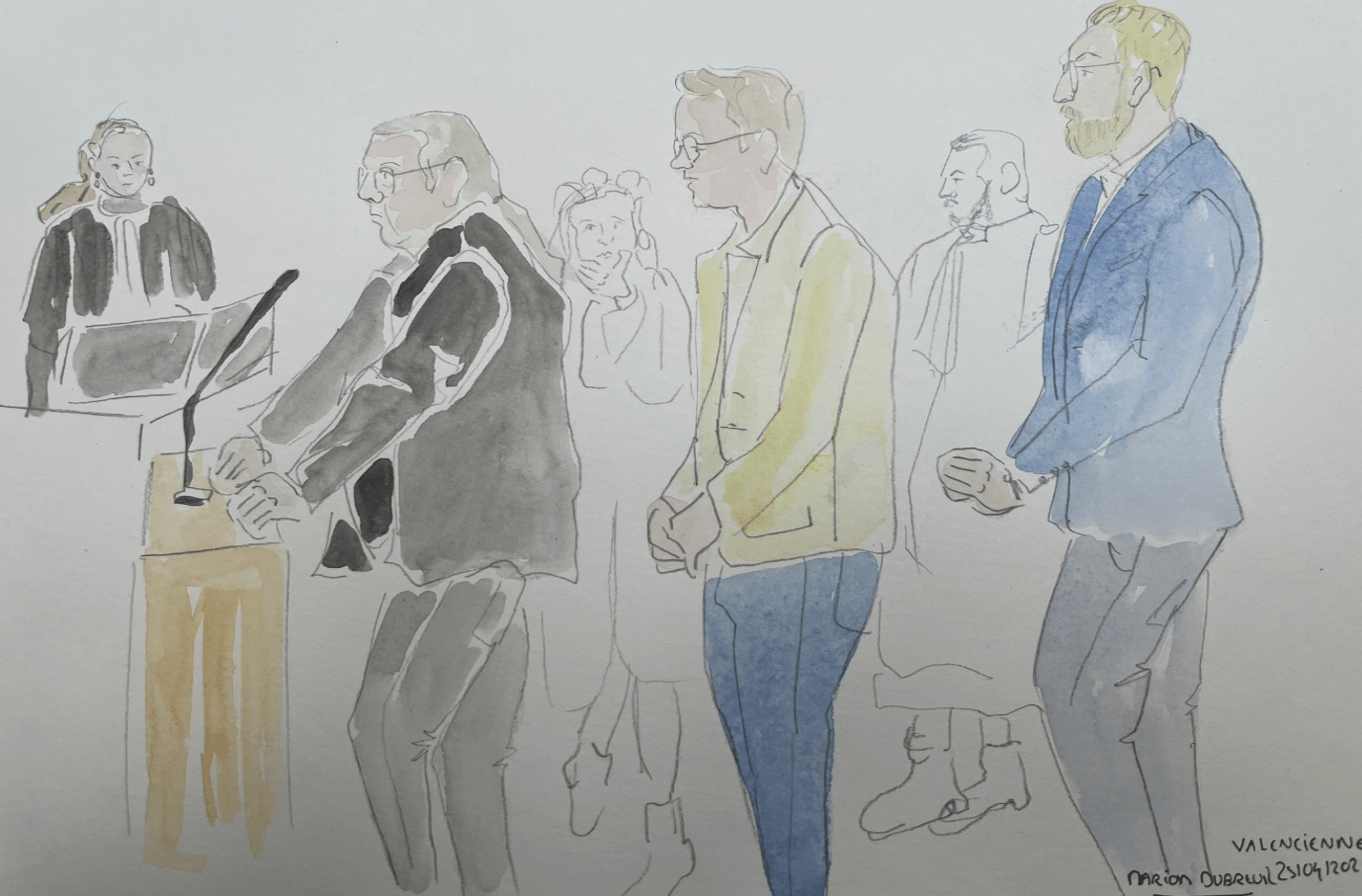
Valenciennes | Justice laxiste pour les 10 hommes accusés de relations sexuelles tarifées avec une collégienne de 14 ans