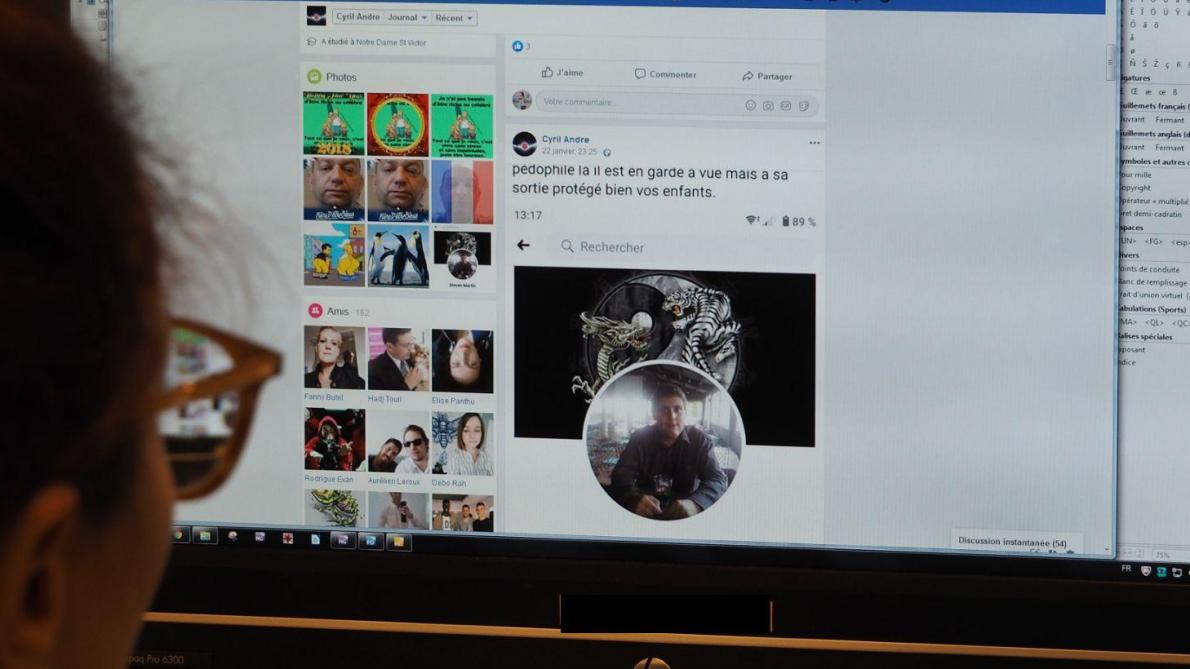Témoignage | Baptiste de Cazenove raconte comment il s’est reconstruit alors qu’il s’est fait violé à l’âge de 4 ans par son maître nageur
- La Prison avec sursis... C'est quoi ?
- 30/06/2019
- 00:00
Catégories :
Mots clés :
«Revivre ce viol m’a submergé de tristesse pour lui, un autre moi, un gamin que j’ai oublié»

Victime de viols à l’âge de 4 ans, Baptiste de Cazenove retrace dans le documentaire «Apnée» sa quête pour reconstituer son passé occulté et s’extirper de ce cauchemar.
Selon le Conseil de l’Europe, un enfant sur cinq serait victime de violences sexuelles. Après la résurgence de flash-back de viols, Baptiste de Cazenove a souhaité raconter son histoire dans un documentaire –à la fois pour que la société prenne conscience de l’impact de ces agressions sur la vie d’un·e adulte, et dans l’espoir de contribuer au timide débat sur ce fléau.
Son film Apnée (52 minutes), coréalisé avec Olivier Laban-Mattei et produit par cocottesminute, sera diffusé sur France 3 le 1er juillet 2019 à 23h45, dans le cadre de la collection «L’Heure D».
Pour Slate, Baptiste de Cazenove livre le récit de la levée de son amnésie traumatique puis de sa reconstruction.
Attention, ce témoignage est particulièrement difficile.
J’ai 28 ans. J’ai grandi en France dans un environnement protégé, au sein d’une famille aisée, et je suis aujourd’hui journaliste, engagé dans la couverture de crises humanitaires à travers le monde. On me dit calme, serviable et conciliant.
Derrière cette image de façade se cache un autre profil, sombre et incontrôlable. Je n’ai jamais compris cette dichotomie. Mais j’ai depuis toujours eu le pressentiment de vivre dans le secret, lesté d’un mal inconnu.
Été 2015, sud de la France. Seul dans la maison de famille, un mas en pierre sèche qui surplombe la garrigue et les champs, je vis exilé en moi-même, débordé d’anxiété depuis mon retour de reportage en Centrafrique.
Du Tchad au Cameroun, six mois viennent de s’écouler. Six mois passés à recueillir la parole de survivants de tortures et de viols. À esquisser avec Olivier Laban-Mattei, un ami photographe, les séquelles des traumatismes subis par les Centrafricains en exil. Cette expérience m’a marqué. Je reste prostré, apathique. Il faudra du temps pour que ces souvenirs trouvent leur place dans ma mémoire.
Peu à peu, je me reconnecte à ma vie en France. Un soir, je retrouve un ami. Il se confie à moi. Je l’écoute médusé. Il me raconte les viols subis dans son enfance, les séquelles, le trauma. S’ensuivent cinq jours de panique, mon corps au bord de l’apoplexie, comme si ces confidences avaient déclenché en moi une mécanique incontrôlable.
Soudain, je suis pris de vertige, mes yeux se ferment, un magma bleu me submerge, un bleu intense, comme l’eau d’une piscine. Je vois un garçon, il a 4 ans. Un maître-nageur, la quarantaine, lui enseigne la natation à la piscine municipale puis l’entraîne dans une pièce. Le gamin le suit, il a confiance. Mes paupières convulsent, ma gorge se noue. L’homme attrape sa nuque et plonge son sexe dans sa bouche. Je suffoque, je m’étrangle. Black-out. Cet enfant, c’était moi. Ou plutôt un autre moi, un gamin que j’ai oublié.
Revivre ce viol m’a submergé de tristesse pour lui, et de colère à l’encontre de notre société, sourde à ces agressions. J’ai alors fait une promesse à ce garçon: tout dire de son drame, porter son cri dans un documentaire.
De retour à Paris, je commence à filmer seul les prémices de cette guerre contre moi-même. Les ténèbres ne tardent pas à me rattraper. Un soir, je pousse la porte d’un bar. J’inhale deux lignes de cocaïne aux toilettes, relève la tête et m’abandonne dans le miroir. Je me dédouble, comme si Lui, l’enfant oublié, cet Autre que je ne connais pas, prenait le contrôle de mon corps d’adulte.
Le voici qui commande un verre en observant les hommes autour du comptoir, sourd à leurs rires, insensible à leurs regards. Puis il s’enfonce dans une ruelle et pousse la porte d’un club gay. Des corps dansent à moitié nus, se frôlent, s’enlacent. La transe l’emporte vers un salon aux volets clos. Les partenaires défilent, des dizaines. Deux jours s’écoulent ainsi, sans manger ni dormir. Et je me retrouve dans la rue, en pleine errance. Je cours aux urgences. On me prescrit une trithérapie post-exposition au VIH.
Au Centre du psychotrauma de l’Institut de victimologie de Paris, une femme derrière son bureau me parle. Mais… je n’entends rien. Ces lèvres bougent pourtant, me dis-je au bout d’un moment. Je tends l’oreille. Elle me regarde, interloquée. Je finis par répondre.
Non, je n’ai encore jamais vu de psychiatre. Non, je n’ai pas pris de cocaïne ce matin avant de venir. Pardon? Ah, ces flash-back… Ces visions à la piscine, elles viennent de surgir. Le déclencheur? Sûrement le stress vécu en Centrafrique, au plus près de l’horreur, puis cette conversation bouleversante avec un ami. D’accord, j’irai également consulter cette psychologue.
À la découverte de l’Autre
Le projet de documentaire me tient toujours à cœur. De retour dans la maison de famille dans le Sud, j’installe une caméra sur trépied dans la salle à manger, avec l’aide précieuse de Marine Courtade, une amie reporter d’images. Puis je reste seul avec ma mère. Elle s’assied au bout de la grande table en noyer, sans trop vouloir prendre au sérieux, tout d’abord, mon air grave. Mais plus je parle, plus ses traits s’étirent.
Rien ne m’arrête, je pars dans une logorrhée, déballant pêle-mêle les rares souvenirs de mon enfance: mon cauchemar récurrent, mes draps mouillés chaque nuit jusqu’à 10 ans, ma tentative de fugue… Ma mère répond par des phrases simples, hésitantes, elle qui conserve au contraire le souvenir d’un enfant jovial, entouré d’amis. Puis elle se tait, et je devine dans son silence la détresse d’une maman dont on a brisé l’enfant.
J’entends tout, ses pleurs, sa rage, ses regrets. J’en tremble. Elle lâche dans un souffle pourquoi, à l’époque, elle m’avait inscrit à ces cours de natation: pour me préserver de la noyade, lors de nos vacances en bord de mer. Je tente de la rassurer. Non, personne n’aurait pu soupçonner ce maître-nageur en qui tout le monde avait confiance. Conquérir le cœur des parents est l’acte premier du prédateur. Et par la suite, personne n’aurait su traduire les symptômes de mon traumatisme. Aucune campagne d’information n’existait alors.
J’épluche mes albums, anxieux de ne pas reconnaître ce môme qui s’affiche sur les photos.
Pour expliquer les raisons de mon silence jusque-là, je lui répète, maladroit et mécanique, les éclairages de la psychiatre: le viol représente une menace mortelle, il induit un stress extrême qui fait –littéralement– disjoncter le cerveau. Au moment de l’agression, la victime scinde son corps et son esprit; elle sort de son corps pour endurer les supplices, sans quoi elle mourrait d’effroi.
Ce réflexe de défense se nomme «dissociation traumatique» et perdure à l’âge adulte. C’est à cela que je dois ma longue amnésie –non seulement l’oubli des viols en eux-mêmes, mais aussi celui des années de vie qui les ont entourés. Ma mère enfouit sa douleur au plus profond, et m’offre l’essentiel dans cette guerre: une alliée.
Les mois filent, entre séances de thérapie, répit et rechutes. Avant de quitter ma mère, j’ai emporté mes cartons poussiéreux. J’ai mis du temps avant de trouver le courage de les ouvrir. Maintenant, je veux comprendre: je pars à la découverte de l’Autre, Lui, l’enfant d’autrefois.
Dans l’appartement que je viens de louer, j’épluche mes albums, anxieux de ne pas reconnaître ce môme qui s’affiche sur les photos avec des moues boudeuses ou des grimaces comiques. Avant d’ouvrir une autre boîte, je prends une longue respiration. C’est celle des dessins oubliés, les dessins de l’Autre, du primaire au lycée. Ici des formes phalliques, là des personnages à la bouche obstruée par une balle ou une main. Des visages qui hurlent. Et toujours ce bleu intense, omniprésent, obsédant, comme une tache indélébile, comme une promesse de noyade.
Dans la foulée, j’exhume ses carnets. Sur l’un d’eux, il avait écrit: «Quand j’aurai percé le secret qui m’habite, je pourrai vivre.» C’était en 2003, il avait 16 ans. J’installe ma caméra face au mur de ma chambre et je commence à y épingler ces messages issus de son inconscient.
Au fil des jours, j’y accroche aussi ses ennuis de jeunesse: condamnations pour ébriété sur la voie publique, détention de stupéfiants, rébellion, outrage à agents, vol, dégradation de biens publics… Je sais maintenant que c’est Lui qui a fait tout ça, par besoin d’anesthésier sa douleur.
Une rencontre avec la mort
Mes consultations avec la psychiatre s’enchaînent. Désormais, j’entends sa voix et suis ses conseils. Avec l’Autre, c’est encore la guerre, il est en moi et il n’en sort pas. J’ai reculé ce moment, mais il faut maintenant affronter l’obscurité.
Je note sur un morceau de papier le souvenir de ses premières expériences sexuelles, à 14 ans, avec des hommes mûrs, dans les cabines d’une piscine municipale. Je le colle sur le mur. J’y épingle aussi des traces de son identité sexuelle: des photographies d’hommes encagoulés, enchaînés dans des caves, reflets de sa fascination pour le masochisme et de ses fantasmes de viols. Et aussi les clichés de ses premiers clients, vestiges de ses cinq années de prostitution…
En ce temps-là, il était étudiant à l’École des beaux-arts, et il présentait ses photos comme une remise en cause «libératrice» des valeurs hétéronormées de la société. Je sais aujourd’hui que ces images reflètent son immense confusion entre sexe et pouvoir, entre affection sincère et domination.
J’observe longtemps ce mur. Toutes ses doubles vies y sont suspendues: le fils idéal et le prostitué, le délinquant aguerri et le garçon bien élevé, le séducteur et l’amant effrayé par l’intimité… Et soudain, quelque chose en moi se glace.
Qui aurais-je été si le maître-nageur ne l’avait pas violé? Mon métier de journaliste, dans lequel je suis soucieux de rendre compte des douleurs d’autrui, ne serait-il donc qu’un palliatif à mon incapacité à crier mes propres souffrances? Qui suis-je aujourd’hui? Vais-je à mon tour reproduire ces violences?
Je sais très bien qu’à 4 ans, je n’étais pas consentant et que je n’avais pas séduit le maître-nageur.
La psychiatre me place sous camisole chimique. Il faut absolument atténuer mon état de stress post-traumatique, diagnostiqué comme sévère. Cette réaction psychologique anxieuse est liée à une rencontre avec la mort –et le viol en est une.
Je plonge néanmoins dans les abysses et l’Autre reprend le dessus. Comme à chaque rechute, il redevient celui que le prédateur en a fait: un objet sexuel. Il enchaîne les sex parties. Plus il inhale de drogues, plus il multiplie les partenaires, jusqu’à se retrouver au bord du gouffre, en danger de mort.
Au réveil, je cours comme un rat dans mon salon, de la table au fauteuil, du fauteuil à la table. Et je manque de fracasser mon visage contre un miroir. Après tout, c’est sûrement cette gueule qui m’a valu cette peine, non?
Mon addictologue veut m’hospitaliser. Las, je me réfugie à l’étranger, entre cauchemars et insomnies. Puis je rentre. Mon suivi s’intensifie, jusqu’à cinq séances hebdomadaires avec presque autant de spécialistes. Je reste sourd à mon cri intérieur. Et face aux médecins, je nie: mais non, je ne vais pas me supprimer; mais non, je ne suis pas tombé dans le piège de la culpabilité, classique chez les victimes qui s’estiment responsables de leur drame.
Je sais très bien qu’à 4 ans, je n’étais pas consentant et que je n’avais pas séduit le maître-nageur. Mais le gamin crie pour tenter de me convaincre: un garçon si mauvais, si laid, a bien mérité d’être violé! Et un soir, c’est ce cri que j’entends résonner comme une évidence: ma vie suinte l’autodestruction, la haine de soi, l’incapacité à être aimé. En un mot, la culpabilité.
Projeté sur le champ de bataille
Cette prise de conscience élémentaire marque un tournant dans mon combat, et le début de la remontée vers la surface. Chaque guerre ayant ses héros, les miens sont déjà là, en première ligne et sans faillir, jamais, malgré le poids et la peur: ma mère et ma cousine Aude, qui acceptent avec courage d’apparaître dans ce documentaire. Et mon «frère» Olivier Laban-Mattei, désormais coréalisateur. À lui l’œil extérieur, à moi la vue subjective, intime. Avec une poignée d’amis fidèles, ils ont resserré les rangs autour de moi.
Ma mère avait retrouvé, dans un énième carton, toutes les vidéo-cassettes de notre enfance. Je les avais aussitôt numérisées. Et puis plus rien. Pendant des mois. Mais maintenant qu’Aude et Olivier m’entourent, je trouve la force de m’y confronter. Sur l’une d’elles, il est écrit: «Piscine […] Baptiste apprend à nager.» Aude s’assied tout près, je lance le film. Apparaissent mon père et mon frère, tout à leur joie dans l’eau, puis le gamin, qui nage gauchement. Un dimanche à la piscine, un dimanche ordinaire.
La caméra pivote. Le maître-nageur apparaît. La caméra remonte sur son visage. J’encaisse. Sur le plan suivant, le môme, frêle et grelottant, est à hauteur du ventre de cet homme qui lui fait répéter des mouvements de brasse. Il lance un regard vers l’objectif, un regard implorant, comme s’il était en quête d’une issue.
D’un geste brusque, l’homme le tourne vers son maillot. Je suis sidéré. Mes yeux s’écarquillent, ma respiration s’accélère. Et d’un coup, le gosse accapare mon corps d’adulte. Il bondit dans le jardin, ses pleurs et ses cris résonnent entre les immeubles. Ses jambes s’emballent, ses pieds frappent le sol. Le monstre est là qui s’insinue en lui. Ses yeux, son visage, son sexe glissent du cerveau à la gorge et de la gorge aux boyaux qui se tordent.
Le gamin se précipite à l’intérieur, file sous la douche et s’ébouillante. Volontairement. À mesure que l’eau déborde sur les faïences indigo, ses gémissements s’apaisent. Je sors de la douche fumant de vapeur.
Il suffit d’un stimulus visuel, tactile ou olfactif pour que le corps se contracte et reproduise les mêmes douleurs.
Je gis pendant dix jours, transi de froid malgré le soleil d’été et les couvertures –les yeux rivés sur les feuilles des arbres. Au moindre bruit, à la moindre lumière inhabituelle, je sursaute.
L’état de stress post-traumatique est ainsi fait: il suffit d’un stimulus visuel, tactile ou olfactif pour que le corps, lieu de mémoire du traumatisme, se contracte et reproduise les mêmes douleurs et les mêmes sensations que celles ressenties lors de l’agression. Je suis projeté sur le champ de bataille de mon enfance.
Je cherche désespérément un abri. Alors je bats en retraite et quitte Paris pour les Cévennes, où j’emménage dans un ancien moulin, coupé du monde par le lit d’une rivière. Cette eau vive m’apaise. Je jardine, je lis et je filme ma réclusion que partagent deux poules affectueuses.
Une heure par jour, je regarde les vidéos tournées autrefois par mes parents. Je commence à renouer le fil de mon enfance. Au calme, je me concentre sur mon retour dans ma ville natale, dans le centre de la France, vingt ans après l’avoir quittée. Je n’y suis jamais retourné.
Une dernière muraille à abattre
Un jour d’hiver, m’y voici enfin, avec Aude. Le froid me saisit alors que je déambule dans ses rues. Olivier nous suit, caméra au poing. Nous franchissons le portail de mon école, en parcourons les couloirs à la recherche d’une réminiscence. La nuit tombe, nous nous retrouvons dans la rue de ma maison d’enfance.
Des fragments de vie émanent de ces lieux, je les sens venir à moi. Tous me reconnectent à un passé finalement ordinaire, fait de joies et de peines toutes simples. Elle était belle aussi, cette enfance, je le sais maintenant. Le poids de mes traumatismes a beau s’alléger, une ligne de front se dresse devant moi: la piscine.
Plus question de renoncer. Il faut pousser la porte. Même si les installations ont été agrandies, je reconnais le bassin principal. L’angoisse monte, et je lis la peur dans le regard d’Aude. Assis sur les gradins, je ferme les yeux et j’hume l’air, saturé de chlore, qui m’entraîne dans la transe. Les bruits sont les mêmes qu’autrefois: les annonces sonores, le fracas au sol des barres métalliques des maîtres-nageurs…
L’Autre émerge à nouveau. Son corps tressaille, en proie au fantôme de son enfance. Il a 4 ans, il subit le viol. Ses paupières se contractent, sa nuque s’affaisse, il avale ses lèvres. Des douleurs violentes le prennent, aux cervicales et aux poignets. Il suffoque.
Aude tend la main et ce toucher me rappelle doucement à la réalité, une réalité sans danger ni menace. Je me contracte, lutte et me répète en moi-même: «Tu es adulte, sois fort!» De tout mon être, j’hurle à l’homme: «Casse toi! Casse toiiii!» Sa silhouette s’évapore. J’ouvre les yeux et j’inspire, comme pour la première fois de ma vie. J’ai terrassé l’ogre de mes jeunes années. Je n’ai plus qu’une obsession: retrouver le prédateur.
Je commence par consulter à contrecœur une avocate, Maître Emelyne Chevrier. Je le sais bien, les viols sur mineurs de moins de 15 ans, des crimes, ne sont prescrits que vingt ans après la majorité de la victime. Mais porter plainte me paraît illusoire. Comment l’emporter sans preuves?
Pourtant, l’avocate le confirme: ces faits, des fellations imposées, peuvent conduire à une condamnation, même vingt-cinq ans après l’agression. Devant mon air incrédule, elle persiste: la cohérence de la plainte d’une victime, son parcours de vie, son état de stress post-traumatique ou sa mémoire corporelle constituent «un faisceau d’indices vraisemblables et sérieux». Des indices qui peuvent être renforcés par les investigations des enquêteurs et les expertises judiciaires, psychologiques et psychiatriques, sans oublier l’enquête sur la personne mise en cause et les signalements éventuels d’autres victimes. «On n’est pas parole contre parole», conclut-elle. Il y a donc un espoir.
Je suis en pleine discussion quand mon téléphone vibre. Un message s’affiche. Je m’effondre en larmes. C’est lui.
Lentement, je me remets à mon travail de journaliste, plus concentré à ma tâche qu’auparavant. Le documentaire prend forme mais demeure incomplet. Il reste une dernière muraille à abattre: retrouver le prédateur. Je passe des heures sur internet, à éplucher les sites d’actualité, en quête d’informations à même d’appuyer mon accusation. Rien n’apparaît. Sauf une piste: son courriel personnel.
Un jour, sans trop y croire, je lui écris en proposant des «retrouvailles» autour d’un verre, pour évoquer le «bon vieux temps». Puis je file rejoindre trois amis dans un café parisien.
Un orage s’abat sur la ville. Je suis en pleine discussion avec mes amis quand mon téléphone vibre. Un message s’affiche. Je m’effondre en larmes. C’est lui. Sa réponse est enthousiaste, désinvolte. Sans nouvelles depuis vingt-cinq ans, cet homme se souvient de moi instantanément.
La Gorgone et moi
Une semaine plus tard, je suis de retour dans la ville de mon enfance. C’est jour de marché, des enfants s’amusent et rient. Et moi j’attends, installé à la terrasse d’un café, les mains bien à plat sur mes cuisses pour ne pas trembler. Je jette un coup d’œil furtif à Olivier et Aude, installés au bar d’en face. Je réajuste le micro dissimulé sous ma chemise et j’engloutis une deuxième dose d’anxiolytique tout en guettant la foule.
Dès qu’il surgit, je le reconnais. Short sportif et polo blanc, l’ogre de mon enfance a l’air d’un papy bienveillant. Mon corps se raidit face à son regard, omniprésent dans mes flash-back. Ce type est ma Gorgone: je me force à le fixer dans les yeux.
Il me serre la main et s’assied, très détendu. Tandis que je tire nerveusement sur ma cigarette, il me parle de tout, de rien. Enfin, pas vraiment de rien. De sa passion pour la chasse. Il m’impose le spectacle de ses trophées, des clichés de biches ensanglantées. Ma gorge se noue. Prédateur est le mot juste.
À mon tour de parler. Je prends une grande inspiration et j’évoque la piscine. Quels souvenirs garde-t-il de nos cours particuliers? «J’ai été agressif?», lâche-t-il avant d’éclater d’un rire gras. Un espoir surgit: il va avouer. La cigarette ne bouge plus au bout de mes doigts. Je souffle, presque dans un râle: «Comment?» Il ânonne: «Peut-être pour faire entrer des… des…» Je me pétrifie. «….Des exercices… éducatifs, peut-être, qui n’étaient pas compris.» Pour ne pas mourir à nouveau, j’expulse ces mots que j’ai mis près de trois ans à pouvoir formuler: «Moi, j’ai des souvenirs différents, des souvenirs d’abus sexuels.» Il reste figé: «Ah bon, à ce point?» Puis rétorque mollement, avec mépris: «Tu dois te tromper de personne, mon pauvre Baptiste!»
Tout innocent aurait hurlé à l’injustice. Pas lui. Cet homme-là maîtrise son jeu. Je lui parle des viols. Il nie. La colère m’envahit. Je lui crache mes blessures au visage: la prostitution, c’est lui. Mes addictions, c’est lui. Mes comportements suicidaires, c’est encore lui. Il m’interrompt, assure avoir la conscience «tranquille».
La Gorgone me regarde. Je vacille. Ma tête s’incline sur la droite, mes paupières se contractent. Je vais être happé par une crise, je le sais. Vite. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Au creux de mon être, venue d’un continent lointain, une petite voix. C’est le gamin. Il est là et sa parole surgit de mes tripes. À l’unisson, nous crions: «J’ai ressenti de la colère, de la honte, de la peur pendant toute mon enfance, jusqu’à aujourd’hui. Je suis libéré de vous. Je peux être adulte, j’ai le droit de vivre.»
Nous avons mis cet homme face à son acte criminel. Nous allons partir. La Gorgone tente de nous retenir: «Ouais bien sûr, mais on va reboire une bière quand même.» Le monstre veut reprendre la main, une minute de plus pour tout annihiler. Nous nous levons, il reste cloué à sa chaise. Et dans un sursaut, il lance: «Un bon weekend à toi… Et embrasse ta maman!»
Lui, c’est moi, et moi, c’est Lui. Je suis Baptiste, j’ai aujourd’hui 31 ans et j’ai renoué les fils de mon existence.
Été 2018, Cévennes. Je suis chez moi, allongé sur mon lit dans la torpeur d’une fin de journée. Je repense à Lui, l’enfant de mon passé. Je me souviens de sa colère. Une colère contre lui-même et son incapacité à se défendre; contre le maître-nageur, meurtrier de son enfance; contre la société, inapte à le protéger. Rien ne me semble désormais plus lointain.
En faisant ce chemin et en déposant plainte contre celui qui a voulu le noyer dans le silence, j’ai retrouvé ce gamin. Lui, c’est moi, et moi, c’est Lui. Je suis Baptiste, j’ai aujourd’hui 31 ans et j’ai renoué les fils de mon existence. Je suis enfin libre d’aimer, libre de m’exprimer. Chaque jour, pourtant, je me demande encore: combien d’enfants autour de nous, comme lui, vivent en apnée?
Source : slate.fr
Source(s):
Les articles en liens


Belgique | Une femme laisserait ses compagnons pratiquer des caresses sexuelles sur sa fille d’accueil, et en imposerait elle-même

Fécamp | Un éducateur fécampois condamné à du sursis pour agressions sexuelles sur 3 ados

Fort-Nieulay | 5 mois ferme en peine aménageable pour une agression sexuelle sur une ado