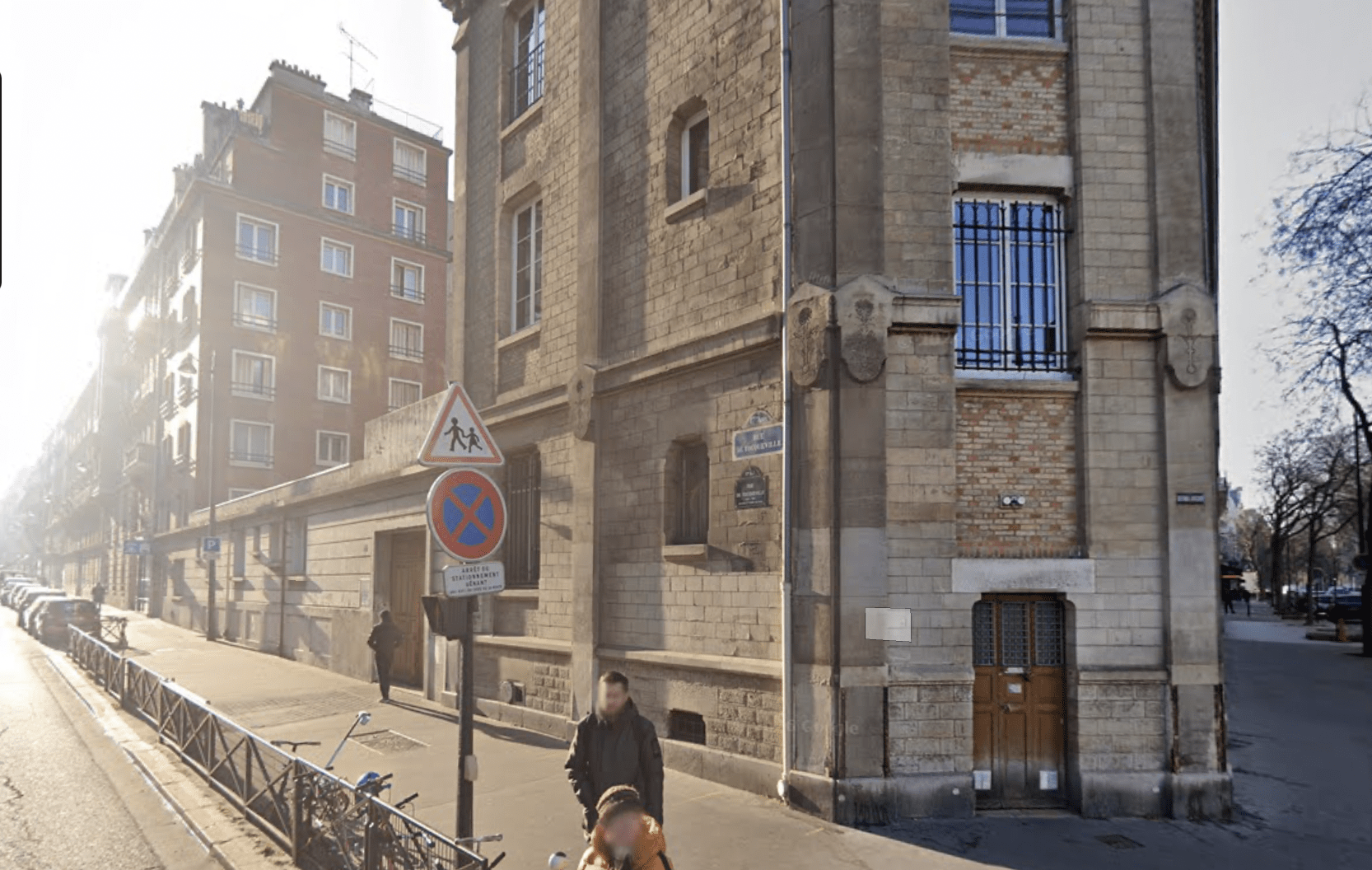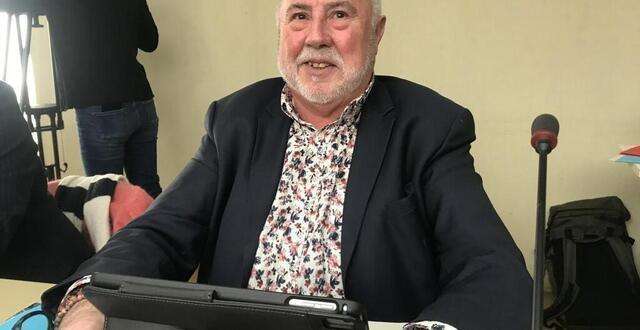Bangladesh | Le drame du mariage forcé des adolescentes
- La Prison avec sursis... C'est quoi ?
oui
Pédocriminel En liberté
- 17/04/2025
- 20:08
Catégories :
Mots clés :

Devant l’étable familiale, là même où elle a accouché, Tajina regarde sa fille de six mois jouer avec un linge, entourée de tantes et de vagues connaissances.
Comme toutes les mères de poupon, elle dort peu la nuit et se réveille constamment pour nourrir sa fille. Mais étant elle-même encore une enfant, elle trouve la situation particulièrement difficile.
« C’est très dur, je suis perdue », confie-t-elle le regard égaré et rempli de tristesse.
« Je n’aime pas mon mari, mais c’est comme ça. Il nous aide avec de l’argent et pour la nourriture. »
Vivant à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Noakhali, au sud-est du Bangladesh, Tajina fait partie de ces milliers de filles qui ont vu leur jeunesse partir en fumée.
Tombée enceinte à 14 ans, elle a été mariée de force l’année d’après, avec un homme d’une trentaine d’années.
À 16 ans, elle est maintenant mère.
Au Bangladesh, grossesses précoces et mariages forcés vont souvent de pair.
Certaines filles tombent enceintes après un viol et doivent se marier avec leur agresseur pour ne pas devenir la honte d’une famille.
La peur du harcèlement sexuel, du viol, voire de l’enlèvement, des jeunes filles contribue à l’augmentation des cas de mariages d’enfants : les familles le perçoivent comme un mécanisme de protection
Dans ce pays où le taux de pauvreté était de 19 % en 2022 et où près de 95 % de la population est de confession musulmane, l’âge minimum du mariage est de 18 ans pour les filles et de 21 ans pour les garçons.
Divers facteurs socio-économiques et culturels continuent toutefois de favoriser les mariages précoces et forcés, ce qui entraîne souvent des violations des lois existantes.
En outre, la loi de 2017 sur la limitation du mariage des enfants comprend une disposition spéciale qui autorise ces unions dans des « circonstances particulières », lorsque les documents d’identité prouvant la majorité ne sont pas fournis, par exemple.
Un rapport de l’UNICEF publié le 8 mars dernier a révélé que, parmi les Bangladaises âgées de 20 à 24 ans, une sur deux avait été mariée avant l’âge de 18 ans, et une sur quatre était devenue mère avant cet âge.
Une réalité qui place le Bangladesh au 8e rang mondial pour la prévalence du mariage des enfants, et au 1er rang en Asie.
L’éducation en jeu
Dans un bidonville en bordure de la ville de Tangail, au centre du pays, Taslima, 18 ans, ouvre timidement les portes du domicile familial pour nous rencontrer.
Celle qui aurait pu devenir « modèle en Europe », selon ses amies, se désole d’être tombée enceinte à 15 ans, puis d’avoir été mariée dans la foulée six mois après
Dans son salon, son fils de trois ans court en tous sens. Les deux premiers mois de sa grossesse ont été un enfer, Taslima vomissant plusieurs fois par jour, avec des crampes similaires à des coups de poignard dans le bas-ventre. Et le jour de l’accouchement est l’un des pires souvenirs de sa vie, confie-t-elle, le regard vert perçant.
Aujourd’hui, bien qu’elle dise s’en sortir financièrement grâce au travail de son mari, elle fait chambre à part.
« L’amour, tu sais ce que c’est toi ? » la taquine sa voisine Tia, amie de longue date.
« Peut-être qu’un jour j’y aurai droit, si j’ai de la chance », répond Taslima en riant.
Dans la majorité des cas, le faible niveau d’éducation des familles entre en jeu.
Selon Care Bangladesh, 68,9 % des femmes qui n’ont pas suivi un enseignement secondaire sont mariées avant l’âge de 18 ans, contre 32 % pour celles qui effectuent ce cycle d’études.
« Bien sûr que ma fille ira à l’école, dit Shuma en s’énervant presque, les larmes aux yeux. Je n’ai ni eu le droit d’étudier, ni même de rêver. »
Née en 2002, elle vient de célébrer ses 22 ans, mais elle n’a pas le cœur à la fête. Elle souhaite se battre pour que ses enfants aient accès à ce qu’elle n’a pas eu.
Extrêmement en colère contre un mari « fainéant et violent », elle est épuisée de jongler entre ses ménages et ses deux enfants.
Sa plus grande erreur, selon elle, fut de ne pas avoir fui la veille de la cérémonie d’union. Ses jambes étaient tétanisées.
« Je n’ai plus de souvenir, c’était une mauvaise journée. Je sais que j’ai pleuré pendant deux jours avant mon mariage. »
Les hommes qui viennent d’épouser une adolescente se révèlent pour la plupart réticents à aborder le sujet, mais pas Majidul, 31 ans, qui accueille Le Devoir dans sa maison à Sirajganj pour nous raconter son mariage.
La cérémonie a eu lieu trois jours auparavant, le henné est toujours visible sur sa main droite, signe d’un mariage religieux.
« C’était la semaine dernière », lance-t-il fièrement, « j’ai choisi Mounia parmi quatre filles. »
Mounia, 17 ans, savait lire et écrire, contrairement aux autres prétendantes ; de plus, elle sait « lire le Coran à la perfection », une condition sine qua non pour Majidul.
« J’aime qu’elle soit sérieuse. Quand je l’ai rencontrée pour voir si elle était au niveau, j’ai dit oui », dit-il.
De son côté, Mounia, rencontrée le lendemain, est triste de devoir bientôt quitter sa madrassa — école coranique — pour devenir femme au foyer. Elle parle peu, mais son regard est rempli d’amertume.
Déconstruire les mentalités
Dans le pays, des projets concrets de sensibilisation et d’éducation sont mis en place depuis quelque temps, notamment grâce à Care Bangladesh et à l’initiative Girls Not Bride (« Des filles, pas des épouses »), antenne d’un réseau mondial de plus de 1400 organismes.
L’initiative fait partie du comité technique chargé d’examiner la loi de 2017 sur la limitation du mariage d’enfants.
Ils ont notamment fait pression sur l’ancien gouvernement, et le feront bientôt sur le nouveau, pour que la loi soit correctement mise en œuvre et que la disposition spéciale autorisant le mariage d’enfants dans des « cas particuliers » ne soit pas utilisée à mauvais escient pour forcer les victimes d’agressions sexuelles ou les femmes enceintes victimes de viol à épouser leurs agresseurs.
Le Devoir a rencontré fin décembre la femme qui a implanté Girls Not Bride au Bangladesh.
Discrète mais sûre d’elle, à seulement 31 ans, Nuha Pabony a le phrasé rapide et le regard vif. Habillée d’un magnifique sari blanc, drapée d’une écharpe rose, elle donne rendez-vous à Ghulsan, quartier huppé de la capitale.
Depuis 2023, elle dirige depuis Dacca un réseau de centaines de femmes qui rencontrent sur le terrain des jeunes filles marginalisées
Concrètement, ses équipes tentent de prévenir ces mariages forcés en informant les filles sur leurs droits et leur accès à l’éducation, ce qui n’est pas une mince affaire.
Le poids des traditions, la mentalité patriarcale et la culture islamique étant très ancrés dans les esprits, le travail des intervenantes doit passer par une certaine déconstruction de l’éducation familiale que ces jeunes filles ont reçue.
Depuis peu, des ateliers de paroles ont été mis en place dans de nombreux districts.
« Les jeunes adolescentes mariées, ou en passe de l’être, ont une santé mentale très fragile, explique Nuha Pabony.
Nous essayons de les aider à exprimer leurs émotions : “Qu’est-ce que je ressens ? Dans la tête, dans le ventre ou dans la poitrine ?
Comment gérer l’anxiété et le stress ?” Nous progressons, petit à petit. »
Durant les révoltes étudiantes de l’été 2024, elle a manifesté avec ses équipes de Girls Not Bride pour renverser l’ancienne première ministre Sheikh Hasina, qui a fui le pays le 5 août dernier pour trouver refuge en Inde.
Les Bangladais espèrent beaucoup du nouveau gouvernement dirigé par Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix 2006, très respecté au Bangladesh.
« Nous plaçons de l’espoir en ce nouveau gouvernement, pour que nous ayons enfin les mêmes droits que les hommes », dit Nuha Pabony.
Des élections législatives sont prévues pour la fin de 2025 ou le début de 2026.
Pour le moment, malgré les actions sur le terrain d’ONG telles que Care Bangladesh ou Save The Children, les voix humanistes et féministes comme celle de Nuha Pabony peinent à se faire entendre, et subissent pressions et intimidations.
Des fatwas, décisions prises par un mufti, selon la loi musulmane, peuvent être brandies pour faire pression sur elles.
« Nous faisons face à des difficultés sur le terrain : des maris violents, des parents également, dit Nuha Pabony. Dès que l’on veut changer les mentalités et faire abolir cette pratique, on peut recevoir des pressions. Ce n’est pas facile, mais nous y arriverons. »
Source(s):
Les articles en liens


Villefranche-sur-Sôane | 7 ans de prison pour le papa pédophile

Ciivise | Accusée d’agression sexuelle la vice-présidente Caroline Rey-Salmon se met en retrait

Avis de recherche – Cédric Mahieu | Témoignage de Blandine Guilloux, pour que «l’affaire reste dans la lumière»